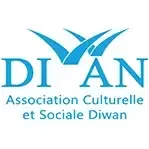Auteur : Rooholamin Amini
Traduit du persan
Au fil des siècles, l’espace culturel persan a vu naître d’illustres figures masculines dans les domaines de l’art et de la pensée. La richesse de cette culture témoigne de sa capacité à engendrer des esprits d’exception. Rien qu’en littérature, des dizaines de personnalités marquantes ont émergé au cours du dernier millénaire, et cette lignée se poursuit jusqu’à notre époque contemporaine.
Cependant, d’un point de vue culturel et sociologique, la condition des femmes a toujours différé de celle des hommes. Cette disparité s’est traduite par une marginalisation des femmes intellectuelles et artistes. Un phénomène qui, bien que mondial, revêt des formes et des intensités variables selon les contextes historiques et géographiques. Une analyse approfondie de cette problématique dépasserait le cadre de cet article.
Malgré ces structures discriminatoires, certaines femmes ont su briller, tant dans le passé qu’à l’époque moderne. Si les conditions sociales leur avaient été plus favorables, elles auraient peut-être occupé des positions dominantes dans divers domaines, ou du moins évolué aux côtés des hommes sur les scènes politique, sociale et culturelle.
Lorsque l’on évoque les grandes figures de la littérature persane, le nom de Mahsati Ganjavi reste méconnu du grand public. Pourtant, elle pourrait être considérée, après Omar Khayyam, comme la deuxième grande poétesse du genre du rubai (quatrain). Elle excellait également dans le style du « Shahrashub », un type de poésie décrivant les métiers et les artisans, au point que certains la considèrent comme la fondatrice de ce genre en littérature persane.
Le fils du relieur, célèbre dans le monde entier,
Tel son sourcil, arqué comme une voûte céleste.
Avec l’aiguille de ses cils, il relie les pages
De tout cœur dont la douleur a dispersé les feuillets.
Rafael Huseynov, dans la préface de l’anthologie des rubaiyat de Mahsati publiée en 1985, souligne que seules quelques-unes de ses œuvres nous sont parvenues :
« Malheureusement, l’ensemble de ses poèmes, fruits d’une vie entière de création, ne nous est pas parvenu. Seule une petite partie de son héritage littéraire, comprenant plus de trois cents quatrains ainsi que quelques pièces et ghazals, est connue grâce à des manuscrits divers et des anthologies poétiques. »
Il est indéniable que les femmes ont été victimes de nombreuses injustices au cours de l’histoire. Le plus douloureux est peut-être l’impact de ces injustices sur l’art, la pensée et le savoir. Nombre de femmes talentueuses sont nées, mais sont mortes dans l’oubli, sans avoir eu l’opportunité de contribuer pleinement à la société. Celles qui ont réussi à s’exprimer ont souvent été effacées des mémoires, calomniées, ou leurs œuvres ont été négligées, ne parvenant pas jusqu’à nous. Aujourd’hui, si l’on cherche des femmes éminentes dans l’histoire culturelle de cette région, au-delà de Rabia et Mahsati, les noms se comptent sur les doigts d’une main. Il faut attendre des siècles pour entendre une voix féminine authentique et officielle dans la poésie, comme celle de Forough Farrokhzad.
Qui était Mahsati Ganjavi ?
Mahsati Ganjavi, poétesse des XIe et XIIe siècles, est l’une des rares femmes à avoir partiellement échappé à la répression historique et sociale. Grâce au soutien de son père, elle entra à l’école dès l’âge de quatre ans. Elle maîtrisait le târ, le oud et le chang. Son amant était le fils du prédicateur de Ganja, mentionné explicitement dans ses poèmes. Elle abordait avec audace des sujets que même les hommes de son époque n’osaient pas traiter, exprimant une perspective féminine claire et une rébellion contre les normes morales et sociales établies. Cette audace reste difficile à accepter pour de nombreux lecteurs, même aujourd’hui.
Lève-toi et viens, j’ai préparé la chambre,
Pour toi, j’ai tendu un rideau élégant.
Partageons grillades et vin ensemble,
Car ces deux plaisirs viennent de mon cœur et de mes yeux.
Les nuits passées à dormir tendrement avec toi sont révolues,
Les perles que j’ai enfilées au bout de mes cils sont perdues.
Tu étais la paix de mon cœur et la compagne de mon âme,
Tu es parti, et tout ce que j’ai partagé avec toi s’est évanoui.
Dans une société où la tradition et la religion occupent une place centrale, de tels propos, surtout de la part d’une femme il y a mille ans, sont difficilement acceptables, tant pour le peuple que pour les élites. Ces dernières, issues du même tissu social, perpétuent les normes culturelles qui façonnent la société. Ce poème n’est pas seulement une confession amoureuse, mais une remise en question des tabous sociaux, une critique voilée des conventions culturelles. Mille ans plus tard, Forough Farrokhzad exprimera une révolte similaire :
Mon bien-aimé,
Avec ce corps nu et sans honte,
Sur ses jambes puissantes,
Se tenait comme la mort.
Même aujourd’hui, ces vers peuvent choquer ceux qui connaissent bien cette culture. S’opposer aux normes sociales dans de telles sociétés équivaut parfois à un suicide symbolique. Pourtant, il est essentiel de reconnaître que Mahsati a ouvert cette voie bien avant Forough. Cela souligne l’injustice historique envers Mahsati et d’autres femmes comme elle, et suggère que notre culture a besoin d’une réévaluation approfondie. Des chercheurs impartiaux doivent revisiter notre passé littéraire et culturel, exposer les injustices, corriger les déformations et éliminer les préjugés pour révéler la véritable richesse de notre héritage.
Mahsati et Khayyam partagent une vision du monde et une philosophie de la vie similaires. La joie de vivre exprimée par Khayyam dans ses rubaiyat est également présente dans les poèmes de Mahsati. Il arrive même que certains de leurs quatrains soient attribués à l’un ou à l’autre, témoignant de leur proximité intellectuelle.
Le courage de Mahsati Ganjavi ne doit pas rester caché derrière le voile de l’intolérance et du sectarisme, même après un millénaire :
On ne peut me retenir par les paroles d’un vieillard,
Ni me confiner dans une chambre sombre.
Celle dont les boucles sont comme des chaînes, Ne peut être gardée enchaînée à la maison.